
WAX SEAL "NAVY AND COLONIES 7th ARRONDISSEMENT (LIVORNO)", First Empire. 31661C
WAX SEAL NAVAL AND COLONIES 7th ARRONDISSEMENT (LIVORNO), First Empire. 31661C
Oval brass seal H 3.5 cm x 3.1 cm, with the Grand Imperial Arms.
France.
First Empire.
Very good condition, without handle.
HISTORIQUE :
L’incorporation de Livourne dans l’empire napoléonien
La progression de la rente immobilière rapproche Livourne des autres sociétés urbaines toscanes et donne à une partie de ses élites la possibilité de profiter des opportunités de promotion sociales et politiques offertes par l’annexion à l’Empire. En imposant une redéfinition des élites construite sur la propriété, l’Empire napoléonien va en effet dans le sens de ce mouvement d’intégration par les classes dominantes. Fondée sur la rente, la notabilité napoléonienne institutionnalise le rapprochement et le brassage des différents éléments des élites toscanes, aristocratie foncière, bourgeoisie propriétaire et négoce. Cependant, l’impact réel de l’insertion dans l’Empire est difficile à évaluer. Outre sa brièveté, la domination napoléonienne a des effets complexes sur Livourne et ses élites. Ainsi, les blocus et les difficultés économiques qui en sont le corollaire tendent les relations entre les négociants et les autorités françaises, mais conduisent aussi le négoce à se tourner davantage vers la rente et l’économie toscane.
L’attitude des élites et de la ville en cette période est d’autant plus complexe que la politique napoléonienne a plusieurs facettes. La contrainte imposée au port et au négoce s’accompagne d’une valorisation politique et administrative de la ville ; la défiance dont le nouveau pouvoir fait montre à l’égard des négociants s’accompagne de leur incorporation massive dans la sphère de la notabilité locale. En retour, l’attitude politique des élites livournaises est contrastée. Elle juxtapose une entrée massive dans la nouvelle sphère de représentation notabiliaire et une forte réticence à exercer des fonctions politiques et administratives proposées. Là encore, la réalité est contrastée et mouvante, car le degré de ralliement des notables livournais varie aussi selon les hommes et les circonstances.
La relance de la guerre en Europe et la mise en place du Blocus continental pousse Napoléon I à prendre plus directement en main les destinées de la Toscane, qui est annexée et incorporée à l’Empire (1808-1814). L’annexion à l’Empire entraîne un profond changement politique et administratif. Le territoire toscan est divisé en trois départements, dits de l’Arno (chef-lieu Florence), de l’Ombrone (chef-lieu Sienne) et de la Méditerranée. Livourne devient la préfecture de ce dernier département, divisé en quatre arrondissements (Pise, Livourne, Volterra, Portoferraio). Le remodelage du territoire selon les normes françaises s’étend aux municipalités, désormais dotées d’un maire et d’un conseil municipal. L’ampleur du changement de statut est mise en évidence par l’impréparation de la ville à accueillir ses nouvelles fonctions, ce que souligne à plusieurs reprises le premier préfet du département de la Méditerranée, Guillaume Capelle : « Livourne ayant acquis très rapidement un accroissement de population et de prospérité, qui l’a portée en peu d’années au rang d’une des villes les plus importantes de l’Europe, manque absolument d’établissements publics tels que ceux que l’on trouve dans les villes même de troisième ordre. Point de halles, point de promenades, un hôpital très insuffisant, des faubourgs qui n’ont pas d’enceinte […] En un mot Livourne n’a pour ainsi dire été jusqu’à ce jour qu’un comptoir, elle va devenir une ville, mais tout est à faire. […] Les bâtiments publics y sont si rares qu’on a été obligé d’établir les deux tribunaux civil et de commerce dans des maisons particulières. »
Pour les autorités françaises, Livourne ne peut être cantonnée dans son rôle de ville portuaire et se doit d’acquérir les attributs nécessaires à l’exercice de ses nouvelles responsabilités politiques et administratives. L’élargissement territorial et politique dont elle bénéficie avec l’annexion, bien que de faible durée, est considérable. Sous les premiers Lorraine, elle n’était le siège d’aucune autorité centrale, et faisait partie de la province pisane. Un premier changement a lieu en 1806, lorsque Livourne est élevée au rang de siège épiscopal. Avec l’annexion, elle ne dépend plus de Florence et devient chef-lieu d’un département, acquérant ainsi de nouvelles fonctions politiques et administratives. Le territoire placé sous son contrôle, qu’il s’agisse de l’arrondissement ou du département, dépasse largement les limites de l’ancien capitanato, pour s’étendre à l’intérieur des terres. Le département de la Méditerranée est composé de trente et un cantons et de soixante-quatre communes. Il comprend l’ancienne province de Pise et une partie de celle de Florence, l’arrondissement de Livourne s’étend jusqu’à San Miniato à l’est et jusqu’à la Maremme au sud. Livourne devient un centre de pouvoir rayonnant sur une large part du territoire toscan.
Ce département de la Méditerranée est divisé en trois sous-préfectures, Livourne, Pise et Volterra. La sous-préfecture de Livourne comprend neuf justices de paix et dix-sept communes, pour une population de 118848 personnes. Le territoire de la commune comprend trois justices de paix, Piazza Grande, Venezia Nuova et Subborghi, correspondant aux trois parties qui composent l’espace urbain. Le fait de ne plus être un port franc est ainsi compensé par une valorisation du rôle politique et administratif de la ville, ce que rappelle le préfet Capelle en 1809 : « Livourne est la résidence d’un évêque, établi seulement depuis deux ans, d’un commissaire général de police, d’un tribunal civil, d’un tribunal de commerce, de trois juges de paix, de six commissaires de police. D’une administration nombreuse de la marine, de la direction générale des douanes de la Toscane, d’une direction d’artillerie, d’une du génie, d’une garnison nombreuse et enfin de tous les autres établissements que renferme le chef-lieu d’un département. »
Ces nouvelles fonctions, et l’importance de la place forte et du port dans le dispositif militaire français, conduisent les nouvelles autorités à envisager un réaménagement du réseau routier toscan, davantage axé sur Livourne. Il est prévu de relier la ville et l’hinterland selon cinq directrices : nord (vers La Spezia), nord-est (vers Lucques et Modène), est (vers Florence), sud-est (vers Sienne) et sud (vers Piombino, et de là en Corse). Un des nombreux projets routiers de l’époque prévoit aussi la construction d’un axe reliant le littoral tyrrhénien et l’Adriatique par Livourne et Ancône. Les réalisations concrètes, sans être négligeables, sont toutefois plus modestes : outre la construction du tronçon San Vincenzo-Piombino et du tronçon de la route impériale quatorze vers Massaciuccoli, au nord du département, l’administration française procède à de nombreuses réfections de ponts, routes et canaux, améliorant nettement la largeur et la qualité des communications avec l’hinterland.
La guerre et les difficultés économiques empêchent que le nouveau cours se traduise par des opérations d’urbanisme. Les projets de travaux portuaires restent lettres mortes, ainsi que l’établissement de nouvelles limites urbaines englobant les faubourgs. Mais la valorisation politique et civile de Livourne est plus importante que ne le laisserait penser la faiblesse des réalisations concrètes et la brièveté de la présence française. Si la Restauration marque le retour aux cadres administratifs antérieurs, l’Empire a en effet permis à Livourne de s’affirmer en Toscane au-delà de son rôle portuaire. Le leg ne restera pas en déshérence. Le vœu du préfet Capelle est en effet repris par une partie de l’élite économique et par l’intelligentsia livournaise de la Restauration. Le sentiment que la ville est incomplète, qu’elle doit acquérir de nouveaux attributs politiques et culturels, qu’il faut l’améliorer pour qu’elle soit à la hauteur de sa place économique, devient, nous le verrons, plus diffus dans les années 1820-1830 et joue un rôle important dans l’affirmation du pôle livournais au sein de la Toscane de la première moitié du XIXe siècle.
En général, l’incorporation de Livourne à l’Empire n’est pourtant pas considérée par l’historiographie comme un fait positif pour la cité. Ce jugement s’appuie surtout sur les effets néfastes de la politique militaire, économique et fiscale de la France : remise en cause des franchises, effets du blocus continental, contrôle tatillon du commerce par l’administration napoléonienne, poids accru de la fiscalité, avec la mise en place de l’octroi aux portes de la ville, les contributions de guerre et la création de la taxe dite du 2 % sur le commerce portuaire, absence d’intérêt réel pour le port, si ce n’est du point de vue stratégique, résultats négatifs de la conscription sur l’économie et la société urbaine… Même si l’on réévalue les effets de cette politique, il apparaît nettement que la période d’annexion à la France, et en particulier les années 1810-1813, marquées par l’alourdissement des contraintes militaires, sont très difficiles pour la population livournaise. Les résistances à l’autorité de la France se développent justement avec l’intensification de la guerre, qui perturbe davantage la vie quotidienne des Livournais. L’importance des mouvements de troupe, qu’il faut parfois loger, le développement de la conscription et la répression de la contrebande, qui apporte un indispensable complément de ressources à de nombreuses familles, nourrissent une hostilité de plus en plus vive et ouverte, en particulier en 1813, lorsque l’édifice impérial commence à faire entendre ses premiers craquements.
L’hostilité croissante à l’Empire est largement due aux circonstances. Mais elle repose aussi sur la faiblesse des soutiens politiques locaux. Le jacobinisme n’a pas eu, à Livourne, une très grande diffusion. Avant l’annexion, les Jacobins actifs sont peu nombreux. Les autorités françaises ne peuvent pas donc pas s’appuyer sur un groupe révolutionnaire local consistant, et cela d’autant plus que la plèbe livournaise, qui manifeste à plusieurs reprises son hostilité à l’idéologie révolutionnaire, exerce une pression non négligeable sur les comportements politiques. Encore convient-il de distinguer ceux des classes dominantes, sur lesquelles le nouveau pouvoir cherche à s’appuyer, de ceux des classes populaires. Dans les années 1790, il existait un petit noyau de « patriotes » locaux, essentiellement issus des classes aisées, propriétaires ou négociants, en général organisés au sein des loges maçonniques. C’est le cas de négociants comme Luigi Dupouy, dont le nom a déjà été évoqué à propos de l’affairisme des années françaises, et Daniel de Medina, cousin du futur président du consistoire et membre d’une des plus importantes familles séfarades de Livourne : tous deux sont des membres actifs de la loge des Amici della Perfetta Unione, créée en 1796 par un commerçant juif venu d’Avignon, Felice Morenas.
Ces adhésions aux idées nouvelles ont été favorisées par le rôle important de l’imprimerie livournaise dans la publication des écrits des Lumières : la première impression italienne de l’Encyclopédie et celle du Des délits et des peines de Beccaria ont lieu à Livourne, qui est alors un des principaux centres d’impression d’Italie et du monde méditerranéen. Livourne et ses réseaux de négociants et de gens de mer occupent une place de premier plan dans la pénétration de ces idées en Toscane. Les relations régulièrement entretenues avec la France et la diffusion de l’influence française, via ces réseaux, favorisent l’apparition de ferments révolutionnaires à Livourne. Une partie des « patriotes » locaux est issue de la colonie française de Livourne, avec une mention particulière pour les Corses, traditionnellement très présents dans la ville et dans le trafic portuaire. Ces derniers fournissent plusieurs exemples de « patriotes » des années 1790 passés ensuite au service de la France napoléonienne. Un négociant comme Philippe Bartolucci, négociant de Livourne né à Bastia, fervent jacobin, est présent dans la franc-maçonnerie livournaise, puis dans la municipalité de l’époque napoléonienne. Certains exercent des responsabilités dès l’époque des Bourbon-Parme, comme Dominique Mattei, propriétaire et noble, corse de Centuri installé à Livourne à la fin du XVIIIe siècle ; présenté comme « pro-français » par le préfet Goyon, successivement directeur des monts-de-piété, commissaire à l’environnement, gouverneur de Livourne (1806- 1808), puis, sous l’Empire, membre du corps législatif et général du corps des chasseurs volontaires de Livourne. Au-delà de ces quelques exemples, la nouvelle administration napoléonienne s’est-elle appuyée sur ces « patriotes » des années 1790 ? Bien peu, en fait, car ils ne représentent qu’une petite minorité, et ne sont pas forcément favorables à l’Empire. Seuls quelques-uns, comme Bartolucci ou Daniel de Medina, entrent dans la municipalité de l’époque impériale, respectivement comme adjoint et conseiller municipal.
L’étroitesse de la base révolutionnaire locale n’épuise cependant pas la question car l’Empire, à Livourne comme dans les autres cités de Toscane et de la péninsule Italienne occupée, cherche un appui plus large au sein des élites, éléments constitutifs des « masses de granit ». Ces élites sont redéfinies. Les privilèges et distinctions antérieurs, en particulier la noblesse et les ordres chevaleresques (dont celui de Saint-Étienne) disparaissent. Anciens nobles et bourgeois propriétaires sont rassemblés dans une élite élargie de la rente. En Toscane, comme d’ailleurs dans la plupart des territoires italiens annexés, cette recomposition n’entraîne pas l’effacement des familles de l’aristocratie, qui s’adaptent au nouveau régime et conservent leurs biens. Certains patrimoines fonciers de l’aristocratie ont même profité de la vente des biens nationaux. Et au sein du haut personnel administratif, les continuités sont fréquentes. Il convient donc d’envisager davantage le changement opéré au sein des élites comme un élargissement de la classe dominante à certaines parties de la bourgeoisie. L’Empire propose aux élites une nouvelle forme de représentation sociale, qui remplace les anciennes nomenclatures par le concept unifiant de notable. Les notables occupent une place fondamentale dans l’idéologie impériale, car ils sont appelés à constituer l’assise du Régime, ces « masses de granit » jugées indispensables. Personnalités locales reconnues, leur soutien doit assurer la stabilité du pouvoir impérial dans les départements, les cantons et les municipalités. Le notable napoléonien est un homme d’influence ayant la confiance du pouvoir politique (confiance validée par des rapports et des listes dressées par les préfets). Pour être considéré comme un notable, il faut en outre jouir d’un bon niveau de fortune, ou au moins d’une solide aisance. Cette condition est indispensable pour participer aux collèges électoraux du département.
Les assemblées de canton, formées de citoyens domiciliés et inscrits dans les listes civiques de cette circonscription désignent des « grands électeurs » qui constituent les collèges électoraux d’arrondissement. Ces derniers désignent à leur tour le collège départemental, qui propose à l’Empereur des candidatures au conseil général, au corps législatif et au sénat. Le recrutement du collège d’arrondissement est relativement large, quoique nécessitant une certaine aisance : il faut être propriétaire, ou vivre d’une rente ou d’un traitement. Par contre, les membres du collège départemental doivent être pris au sein des six cent plus imposés du département. Cette condition de cens vaut aussi pour la constitution des conseils municipaux dans les villes de plus de cinq mille habitants, dont les trente membres sont proposés par les assemblées de canton à la nomination de l’Empereur, parmi les cent individus les plus imposés de la commune. Si l’on se souvient que la taxe foncière constitue le principal impôt de la période, il apparaîtra nettement que la notabilité napoléonienne se définit surtout comme une élite du cens et de la propriété.
La promotion politique de la rente est très nette lorsqu’on observe le statut des cent plus imposés de la commune de Livourne. La liste comporte une rubrique « profession et fonctions », définissant la qualité de chaque notable avant et après l’annexion. Le nombre des individus simplement définis comme « négociant » passe de trente à dix-neuf, tandis que ceux définis seulement comme « rentiers » passent de seize à trente-six. Globalement, le nombre d’individus définis uniquement par leur activité professionnelle baisse de moitié. La constitution d’une liste dominée par l’état de rentier et de propriétaire (aux trente-six on ajoutera sept « négociants rentiers » et dix « propriétaires », sans compter les individus définis à la fois par une profession et par l’état de rentier) ne signifie pas seulement les progrès de la rente livournaise, mais aussi, et surtout, qu’une définition officielle et unifiante de l’élite locale se construit autour du statut de notable propriétaire-rentier. Plus qu’à un abandon de l’activité négociante, qui reste limité, ces changements d’appellation mettent donc en valeur la reformulation des élites à l’époque de l’annexion. D’autant que l’intégration dans la France impériale ne met pas l’argent, la richesse mobilière et la marchandise au centre de la société. Napoléon fait d’ailleurs montre d’un « mépris de fer à l’égard des formes spéculatives de l’enrichissement ». Le négoce, dont l’activité est fragilisée par la guerre et la suppression des franchises, beaucoup plus dépendante des volontés de l’administration française, est davantage considéré comme un groupe professionnel qu’il convient d’encadrer.
Cette volonté de contrôle est nettement affirmée par le décret du 2 septembre 1808, puis celui du 12 août 1813. Le préfet devient le président d’office de la chambre de commerce, dont les réunions périodiques ordinaires doivent être déterminées à l’avance ; et quand le vice-président veut convoquer une assemblée extraordinaire, il doit au préalable en informer le préfet et lui faire connaître le but de la réunion. Les séances non présidées par le préfet doivent obligatoirement être soumises à son approbation. Outre la responsabilité de présenter des propositions sur les moyens d’accroître la prospérité du commerce, la chambre doit surveiller l’exécution des travaux publics relatifs au commerce (comme le maintien du port) et s’assurer de l’exécution des lois et décret concernant la contrebande. Elle est ainsi étroitement cantonnée dans les questions du commerce, et même instrumentalisée par l’administration dans sa lutte contre la fraude. Le recrutement des quinze membres de la chambre ne se fait plus en fonction de la « nation » : il faut seulement avoir exercé le commerce pendant dix ans pour pouvoir être député, ce qui valorise d’abord la solidité professionnelle et l’expérience des postulants. Il n’en reste pas moins que sur les vingt-six négociants qui président la chambre de commerce entre 1808 et 1813 (les présidents changent tous les deux mois), quatorze, soit la majorité, sont issus des anciennes « nations » grecque, anglaise, juive et oltramontana (Suisses et Allemands). Parmi les présidents de la chambre, on retrouve ceux qui l’ont animés au moment de sa fondation, les Dupouy, Filicchi, Costacchi, Senn, Abudharam, Uzielli, Grant, Mille… qui sont aussi les principaux négociants de la place. Le groupe qui s’était soudé dans les années du royaume d’Étrurie reste donc aux commandes de la chambre et peut traverser la période impériale. La création des tribunaux de commerce, qui ont compétence sur toutes les affaires commerciales, leur permet même d’élargir leur pouvoir sur le milieu. De plus, si le négoce en tant que groupe social n’est pas l’objet d’une sollicitude comparable au monde de la rente, ses membres peuvent librement intégrer la nouvelle élite napoléonienne. Étant donné leur poids dans la propriété communale, il semble d’ailleurs difficile de se passer d’eux. Ainsi, l’administration française tente d’incorporer les plus riches et les plus influents des négociants dans la notabilité impériale.
Mais avant de préciser l’ampleur et la réussite de cette collaboration, il convient au préalable de mesurer la place des Livournais dans la notabilité du département de la Méditerranée, et de déterminer qui sont exactement les Livournais considérés comme tels. La liste des six cent plus imposés du département de la Méditerranée, établie en mai 1812, met en évidence la domination globale de Livourne, avec deux cent quinze des six cent imposés (35,8 %), alors que la ville ne rassemble que 15 % des habitants du département. Dans la mesure où l’évaluation du revenu valorise la richesse foncière au détriment de ceux du commerce, ce chiffre met en évidence la robustesse de la propriété livournaise. De plus, parmi les sept Livournais les plus imposés du département, cinq sont des négociants, ce qui, outre la traditionnelle domination du négoce dans la richesse de la ville, confirme les progrès de la propriété négociante. La liste met aussi en évidence le poids de la propriété juive : le Livournais le plus imposé est Salomon de Montel, juif et négociant, qui apparaît en septième position. Un autre juif négociant, David Busnach, est dixième. Trois acquéreurs de biens nationaux figurent parmi les sept : Vincent (Vincenzo) Danty, François (Francesco) Bicchierai, Jean Baptiste (Giovanni Battista) Calamai. Par contre, les Livournais sont bien moins représentés parmi les trente premiers de cette liste : seulement sept, contre quatorze Pisans. Si la liste met en évidence la diffusion de la propriété livournaise, elle montre aussi qu’il ne s’agit pas souvent de grande propriété. Livourne reste avant tout une ville de commerce, et la grande propriété est encore et d’abord le fait de l’aristocratie pisane. (les cinq premiers contribuables sont tous domiciliés à Pise). Dans le département, le notable rentier domine le négociant, et la grande propriété pisane une propriété livournaise dont l’expansion hors du terroir reste encore, malgré certains progrès, limitée. Cette relative faiblesse de la notabilité livournaise dans le département est confirmée par la « liste des personnes les plus marquantes du département », dressée par le préfet afin de déterminer les candidats pour la présidence des collèges électoraux. Sur soixante individus, neuf seulement ont Livourne comme « domicile politique » (dont un, Castinelli, semble davantage lié à Pise), contre vingt-trois à Pise, tandis qu’avec huit noms, Volterra est presque autant représentée que le chef-lieu de département. De plus, sur les vingt membres du conseil général, seuls sept sont livournais. Ces derniers sont aussi minoritaires, de peu il est vrai, dans le conseil d’arrondissement (cinq sur onze).
source : Publications de l’École française de Rome :https://www.bertrand-malvaux.fr/admin/1/Produits/48955/form/update?controllerName=Produits
Oval brass seal H 3.5 cm x 3.1 cm, with the Grand Imperial Arms.
France.
First Empire.
Very good condition, without handle.
HISTORIQUE :
L’incorporation de Livourne dans l’empire napoléonien
La progression de la rente immobilière rapproche Livourne des autres sociétés urbaines toscanes et donne à une partie de ses élites la possibilité de profiter des opportunités de promotion sociales et politiques offertes par l’annexion à l’Empire. En imposant une redéfinition des élites construite sur la propriété, l’Empire napoléonien va en effet dans le sens de ce mouvement d’intégration par les classes dominantes. Fondée sur la rente, la notabilité napoléonienne institutionnalise le rapprochement et le brassage des différents éléments des élites toscanes, aristocratie foncière, bourgeoisie propriétaire et négoce. Cependant, l’impact réel de l’insertion dans l’Empire est difficile à évaluer. Outre sa brièveté, la domination napoléonienne a des effets complexes sur Livourne et ses élites. Ainsi, les blocus et les difficultés économiques qui en sont le corollaire tendent les relations entre les négociants et les autorités françaises, mais conduisent aussi le négoce à se tourner davantage vers la rente et l’économie toscane.
L’attitude des élites et de la ville en cette période est d’autant plus complexe que la politique napoléonienne a plusieurs facettes. La contrainte imposée au port et au négoce s’accompagne d’une valorisation politique et administrative de la ville ; la défiance dont le nouveau pouvoir fait montre à l’égard des négociants s’accompagne de leur incorporation massive dans la sphère de la notabilité locale. En retour, l’attitude politique des élites livournaises est contrastée. Elle juxtapose une entrée massive dans la nouvelle sphère de représentation notabiliaire et une forte réticence à exercer des fonctions politiques et administratives proposées. Là encore, la réalité est contrastée et mouvante, car le degré de ralliement des notables livournais varie aussi selon les hommes et les circonstances.
La relance de la guerre en Europe et la mise en place du Blocus continental pousse Napoléon I à prendre plus directement en main les destinées de la Toscane, qui est annexée et incorporée à l’Empire (1808-1814). L’annexion à l’Empire entraîne un profond changement politique et administratif. Le territoire toscan est divisé en trois départements, dits de l’Arno (chef-lieu Florence), de l’Ombrone (chef-lieu Sienne) et de la Méditerranée. Livourne devient la préfecture de ce dernier département, divisé en quatre arrondissements (Pise, Livourne, Volterra, Portoferraio). Le remodelage du territoire selon les normes françaises s’étend aux municipalités, désormais dotées d’un maire et d’un conseil municipal. L’ampleur du changement de statut est mise en évidence par l’impréparation de la ville à accueillir ses nouvelles fonctions, ce que souligne à plusieurs reprises le premier préfet du département de la Méditerranée, Guillaume Capelle : « Livourne ayant acquis très rapidement un accroissement de population et de prospérité, qui l’a portée en peu d’années au rang d’une des villes les plus importantes de l’Europe, manque absolument d’établissements publics tels que ceux que l’on trouve dans les villes même de troisième ordre. Point de halles, point de promenades, un hôpital très insuffisant, des faubourgs qui n’ont pas d’enceinte […] En un mot Livourne n’a pour ainsi dire été jusqu’à ce jour qu’un comptoir, elle va devenir une ville, mais tout est à faire. […] Les bâtiments publics y sont si rares qu’on a été obligé d’établir les deux tribunaux civil et de commerce dans des maisons particulières. »
Pour les autorités françaises, Livourne ne peut être cantonnée dans son rôle de ville portuaire et se doit d’acquérir les attributs nécessaires à l’exercice de ses nouvelles responsabilités politiques et administratives. L’élargissement territorial et politique dont elle bénéficie avec l’annexion, bien que de faible durée, est considérable. Sous les premiers Lorraine, elle n’était le siège d’aucune autorité centrale, et faisait partie de la province pisane. Un premier changement a lieu en 1806, lorsque Livourne est élevée au rang de siège épiscopal. Avec l’annexion, elle ne dépend plus de Florence et devient chef-lieu d’un département, acquérant ainsi de nouvelles fonctions politiques et administratives. Le territoire placé sous son contrôle, qu’il s’agisse de l’arrondissement ou du département, dépasse largement les limites de l’ancien capitanato, pour s’étendre à l’intérieur des terres. Le département de la Méditerranée est composé de trente et un cantons et de soixante-quatre communes. Il comprend l’ancienne province de Pise et une partie de celle de Florence, l’arrondissement de Livourne s’étend jusqu’à San Miniato à l’est et jusqu’à la Maremme au sud. Livourne devient un centre de pouvoir rayonnant sur une large part du territoire toscan.
Ce département de la Méditerranée est divisé en trois sous-préfectures, Livourne, Pise et Volterra. La sous-préfecture de Livourne comprend neuf justices de paix et dix-sept communes, pour une population de 118848 personnes. Le territoire de la commune comprend trois justices de paix, Piazza Grande, Venezia Nuova et Subborghi, correspondant aux trois parties qui composent l’espace urbain. Le fait de ne plus être un port franc est ainsi compensé par une valorisation du rôle politique et administratif de la ville, ce que rappelle le préfet Capelle en 1809 : « Livourne est la résidence d’un évêque, établi seulement depuis deux ans, d’un commissaire général de police, d’un tribunal civil, d’un tribunal de commerce, de trois juges de paix, de six commissaires de police. D’une administration nombreuse de la marine, de la direction générale des douanes de la Toscane, d’une direction d’artillerie, d’une du génie, d’une garnison nombreuse et enfin de tous les autres établissements que renferme le chef-lieu d’un département. »
Ces nouvelles fonctions, et l’importance de la place forte et du port dans le dispositif militaire français, conduisent les nouvelles autorités à envisager un réaménagement du réseau routier toscan, davantage axé sur Livourne. Il est prévu de relier la ville et l’hinterland selon cinq directrices : nord (vers La Spezia), nord-est (vers Lucques et Modène), est (vers Florence), sud-est (vers Sienne) et sud (vers Piombino, et de là en Corse). Un des nombreux projets routiers de l’époque prévoit aussi la construction d’un axe reliant le littoral tyrrhénien et l’Adriatique par Livourne et Ancône. Les réalisations concrètes, sans être négligeables, sont toutefois plus modestes : outre la construction du tronçon San Vincenzo-Piombino et du tronçon de la route impériale quatorze vers Massaciuccoli, au nord du département, l’administration française procède à de nombreuses réfections de ponts, routes et canaux, améliorant nettement la largeur et la qualité des communications avec l’hinterland.
La guerre et les difficultés économiques empêchent que le nouveau cours se traduise par des opérations d’urbanisme. Les projets de travaux portuaires restent lettres mortes, ainsi que l’établissement de nouvelles limites urbaines englobant les faubourgs. Mais la valorisation politique et civile de Livourne est plus importante que ne le laisserait penser la faiblesse des réalisations concrètes et la brièveté de la présence française. Si la Restauration marque le retour aux cadres administratifs antérieurs, l’Empire a en effet permis à Livourne de s’affirmer en Toscane au-delà de son rôle portuaire. Le leg ne restera pas en déshérence. Le vœu du préfet Capelle est en effet repris par une partie de l’élite économique et par l’intelligentsia livournaise de la Restauration. Le sentiment que la ville est incomplète, qu’elle doit acquérir de nouveaux attributs politiques et culturels, qu’il faut l’améliorer pour qu’elle soit à la hauteur de sa place économique, devient, nous le verrons, plus diffus dans les années 1820-1830 et joue un rôle important dans l’affirmation du pôle livournais au sein de la Toscane de la première moitié du XIXe siècle.
En général, l’incorporation de Livourne à l’Empire n’est pourtant pas considérée par l’historiographie comme un fait positif pour la cité. Ce jugement s’appuie surtout sur les effets néfastes de la politique militaire, économique et fiscale de la France : remise en cause des franchises, effets du blocus continental, contrôle tatillon du commerce par l’administration napoléonienne, poids accru de la fiscalité, avec la mise en place de l’octroi aux portes de la ville, les contributions de guerre et la création de la taxe dite du 2 % sur le commerce portuaire, absence d’intérêt réel pour le port, si ce n’est du point de vue stratégique, résultats négatifs de la conscription sur l’économie et la société urbaine… Même si l’on réévalue les effets de cette politique, il apparaît nettement que la période d’annexion à la France, et en particulier les années 1810-1813, marquées par l’alourdissement des contraintes militaires, sont très difficiles pour la population livournaise. Les résistances à l’autorité de la France se développent justement avec l’intensification de la guerre, qui perturbe davantage la vie quotidienne des Livournais. L’importance des mouvements de troupe, qu’il faut parfois loger, le développement de la conscription et la répression de la contrebande, qui apporte un indispensable complément de ressources à de nombreuses familles, nourrissent une hostilité de plus en plus vive et ouverte, en particulier en 1813, lorsque l’édifice impérial commence à faire entendre ses premiers craquements.
L’hostilité croissante à l’Empire est largement due aux circonstances. Mais elle repose aussi sur la faiblesse des soutiens politiques locaux. Le jacobinisme n’a pas eu, à Livourne, une très grande diffusion. Avant l’annexion, les Jacobins actifs sont peu nombreux. Les autorités françaises ne peuvent pas donc pas s’appuyer sur un groupe révolutionnaire local consistant, et cela d’autant plus que la plèbe livournaise, qui manifeste à plusieurs reprises son hostilité à l’idéologie révolutionnaire, exerce une pression non négligeable sur les comportements politiques. Encore convient-il de distinguer ceux des classes dominantes, sur lesquelles le nouveau pouvoir cherche à s’appuyer, de ceux des classes populaires. Dans les années 1790, il existait un petit noyau de « patriotes » locaux, essentiellement issus des classes aisées, propriétaires ou négociants, en général organisés au sein des loges maçonniques. C’est le cas de négociants comme Luigi Dupouy, dont le nom a déjà été évoqué à propos de l’affairisme des années françaises, et Daniel de Medina, cousin du futur président du consistoire et membre d’une des plus importantes familles séfarades de Livourne : tous deux sont des membres actifs de la loge des Amici della Perfetta Unione, créée en 1796 par un commerçant juif venu d’Avignon, Felice Morenas.
Ces adhésions aux idées nouvelles ont été favorisées par le rôle important de l’imprimerie livournaise dans la publication des écrits des Lumières : la première impression italienne de l’Encyclopédie et celle du Des délits et des peines de Beccaria ont lieu à Livourne, qui est alors un des principaux centres d’impression d’Italie et du monde méditerranéen. Livourne et ses réseaux de négociants et de gens de mer occupent une place de premier plan dans la pénétration de ces idées en Toscane. Les relations régulièrement entretenues avec la France et la diffusion de l’influence française, via ces réseaux, favorisent l’apparition de ferments révolutionnaires à Livourne. Une partie des « patriotes » locaux est issue de la colonie française de Livourne, avec une mention particulière pour les Corses, traditionnellement très présents dans la ville et dans le trafic portuaire. Ces derniers fournissent plusieurs exemples de « patriotes » des années 1790 passés ensuite au service de la France napoléonienne. Un négociant comme Philippe Bartolucci, négociant de Livourne né à Bastia, fervent jacobin, est présent dans la franc-maçonnerie livournaise, puis dans la municipalité de l’époque napoléonienne. Certains exercent des responsabilités dès l’époque des Bourbon-Parme, comme Dominique Mattei, propriétaire et noble, corse de Centuri installé à Livourne à la fin du XVIIIe siècle ; présenté comme « pro-français » par le préfet Goyon, successivement directeur des monts-de-piété, commissaire à l’environnement, gouverneur de Livourne (1806- 1808), puis, sous l’Empire, membre du corps législatif et général du corps des chasseurs volontaires de Livourne. Au-delà de ces quelques exemples, la nouvelle administration napoléonienne s’est-elle appuyée sur ces « patriotes » des années 1790 ? Bien peu, en fait, car ils ne représentent qu’une petite minorité, et ne sont pas forcément favorables à l’Empire. Seuls quelques-uns, comme Bartolucci ou Daniel de Medina, entrent dans la municipalité de l’époque impériale, respectivement comme adjoint et conseiller municipal.
L’étroitesse de la base révolutionnaire locale n’épuise cependant pas la question car l’Empire, à Livourne comme dans les autres cités de Toscane et de la péninsule Italienne occupée, cherche un appui plus large au sein des élites, éléments constitutifs des « masses de granit ». Ces élites sont redéfinies. Les privilèges et distinctions antérieurs, en particulier la noblesse et les ordres chevaleresques (dont celui de Saint-Étienne) disparaissent. Anciens nobles et bourgeois propriétaires sont rassemblés dans une élite élargie de la rente. En Toscane, comme d’ailleurs dans la plupart des territoires italiens annexés, cette recomposition n’entraîne pas l’effacement des familles de l’aristocratie, qui s’adaptent au nouveau régime et conservent leurs biens. Certains patrimoines fonciers de l’aristocratie ont même profité de la vente des biens nationaux. Et au sein du haut personnel administratif, les continuités sont fréquentes. Il convient donc d’envisager davantage le changement opéré au sein des élites comme un élargissement de la classe dominante à certaines parties de la bourgeoisie. L’Empire propose aux élites une nouvelle forme de représentation sociale, qui remplace les anciennes nomenclatures par le concept unifiant de notable. Les notables occupent une place fondamentale dans l’idéologie impériale, car ils sont appelés à constituer l’assise du Régime, ces « masses de granit » jugées indispensables. Personnalités locales reconnues, leur soutien doit assurer la stabilité du pouvoir impérial dans les départements, les cantons et les municipalités. Le notable napoléonien est un homme d’influence ayant la confiance du pouvoir politique (confiance validée par des rapports et des listes dressées par les préfets). Pour être considéré comme un notable, il faut en outre jouir d’un bon niveau de fortune, ou au moins d’une solide aisance. Cette condition est indispensable pour participer aux collèges électoraux du département.
Les assemblées de canton, formées de citoyens domiciliés et inscrits dans les listes civiques de cette circonscription désignent des « grands électeurs » qui constituent les collèges électoraux d’arrondissement. Ces derniers désignent à leur tour le collège départemental, qui propose à l’Empereur des candidatures au conseil général, au corps législatif et au sénat. Le recrutement du collège d’arrondissement est relativement large, quoique nécessitant une certaine aisance : il faut être propriétaire, ou vivre d’une rente ou d’un traitement. Par contre, les membres du collège départemental doivent être pris au sein des six cent plus imposés du département. Cette condition de cens vaut aussi pour la constitution des conseils municipaux dans les villes de plus de cinq mille habitants, dont les trente membres sont proposés par les assemblées de canton à la nomination de l’Empereur, parmi les cent individus les plus imposés de la commune. Si l’on se souvient que la taxe foncière constitue le principal impôt de la période, il apparaîtra nettement que la notabilité napoléonienne se définit surtout comme une élite du cens et de la propriété.
La promotion politique de la rente est très nette lorsqu’on observe le statut des cent plus imposés de la commune de Livourne. La liste comporte une rubrique « profession et fonctions », définissant la qualité de chaque notable avant et après l’annexion. Le nombre des individus simplement définis comme « négociant » passe de trente à dix-neuf, tandis que ceux définis seulement comme « rentiers » passent de seize à trente-six. Globalement, le nombre d’individus définis uniquement par leur activité professionnelle baisse de moitié. La constitution d’une liste dominée par l’état de rentier et de propriétaire (aux trente-six on ajoutera sept « négociants rentiers » et dix « propriétaires », sans compter les individus définis à la fois par une profession et par l’état de rentier) ne signifie pas seulement les progrès de la rente livournaise, mais aussi, et surtout, qu’une définition officielle et unifiante de l’élite locale se construit autour du statut de notable propriétaire-rentier. Plus qu’à un abandon de l’activité négociante, qui reste limité, ces changements d’appellation mettent donc en valeur la reformulation des élites à l’époque de l’annexion. D’autant que l’intégration dans la France impériale ne met pas l’argent, la richesse mobilière et la marchandise au centre de la société. Napoléon fait d’ailleurs montre d’un « mépris de fer à l’égard des formes spéculatives de l’enrichissement ». Le négoce, dont l’activité est fragilisée par la guerre et la suppression des franchises, beaucoup plus dépendante des volontés de l’administration française, est davantage considéré comme un groupe professionnel qu’il convient d’encadrer.
Cette volonté de contrôle est nettement affirmée par le décret du 2 septembre 1808, puis celui du 12 août 1813. Le préfet devient le président d’office de la chambre de commerce, dont les réunions périodiques ordinaires doivent être déterminées à l’avance ; et quand le vice-président veut convoquer une assemblée extraordinaire, il doit au préalable en informer le préfet et lui faire connaître le but de la réunion. Les séances non présidées par le préfet doivent obligatoirement être soumises à son approbation. Outre la responsabilité de présenter des propositions sur les moyens d’accroître la prospérité du commerce, la chambre doit surveiller l’exécution des travaux publics relatifs au commerce (comme le maintien du port) et s’assurer de l’exécution des lois et décret concernant la contrebande. Elle est ainsi étroitement cantonnée dans les questions du commerce, et même instrumentalisée par l’administration dans sa lutte contre la fraude. Le recrutement des quinze membres de la chambre ne se fait plus en fonction de la « nation » : il faut seulement avoir exercé le commerce pendant dix ans pour pouvoir être député, ce qui valorise d’abord la solidité professionnelle et l’expérience des postulants. Il n’en reste pas moins que sur les vingt-six négociants qui président la chambre de commerce entre 1808 et 1813 (les présidents changent tous les deux mois), quatorze, soit la majorité, sont issus des anciennes « nations » grecque, anglaise, juive et oltramontana (Suisses et Allemands). Parmi les présidents de la chambre, on retrouve ceux qui l’ont animés au moment de sa fondation, les Dupouy, Filicchi, Costacchi, Senn, Abudharam, Uzielli, Grant, Mille… qui sont aussi les principaux négociants de la place. Le groupe qui s’était soudé dans les années du royaume d’Étrurie reste donc aux commandes de la chambre et peut traverser la période impériale. La création des tribunaux de commerce, qui ont compétence sur toutes les affaires commerciales, leur permet même d’élargir leur pouvoir sur le milieu. De plus, si le négoce en tant que groupe social n’est pas l’objet d’une sollicitude comparable au monde de la rente, ses membres peuvent librement intégrer la nouvelle élite napoléonienne. Étant donné leur poids dans la propriété communale, il semble d’ailleurs difficile de se passer d’eux. Ainsi, l’administration française tente d’incorporer les plus riches et les plus influents des négociants dans la notabilité impériale.
Mais avant de préciser l’ampleur et la réussite de cette collaboration, il convient au préalable de mesurer la place des Livournais dans la notabilité du département de la Méditerranée, et de déterminer qui sont exactement les Livournais considérés comme tels. La liste des six cent plus imposés du département de la Méditerranée, établie en mai 1812, met en évidence la domination globale de Livourne, avec deux cent quinze des six cent imposés (35,8 %), alors que la ville ne rassemble que 15 % des habitants du département. Dans la mesure où l’évaluation du revenu valorise la richesse foncière au détriment de ceux du commerce, ce chiffre met en évidence la robustesse de la propriété livournaise. De plus, parmi les sept Livournais les plus imposés du département, cinq sont des négociants, ce qui, outre la traditionnelle domination du négoce dans la richesse de la ville, confirme les progrès de la propriété négociante. La liste met aussi en évidence le poids de la propriété juive : le Livournais le plus imposé est Salomon de Montel, juif et négociant, qui apparaît en septième position. Un autre juif négociant, David Busnach, est dixième. Trois acquéreurs de biens nationaux figurent parmi les sept : Vincent (Vincenzo) Danty, François (Francesco) Bicchierai, Jean Baptiste (Giovanni Battista) Calamai. Par contre, les Livournais sont bien moins représentés parmi les trente premiers de cette liste : seulement sept, contre quatorze Pisans. Si la liste met en évidence la diffusion de la propriété livournaise, elle montre aussi qu’il ne s’agit pas souvent de grande propriété. Livourne reste avant tout une ville de commerce, et la grande propriété est encore et d’abord le fait de l’aristocratie pisane. (les cinq premiers contribuables sont tous domiciliés à Pise). Dans le département, le notable rentier domine le négociant, et la grande propriété pisane une propriété livournaise dont l’expansion hors du terroir reste encore, malgré certains progrès, limitée. Cette relative faiblesse de la notabilité livournaise dans le département est confirmée par la « liste des personnes les plus marquantes du département », dressée par le préfet afin de déterminer les candidats pour la présidence des collèges électoraux. Sur soixante individus, neuf seulement ont Livourne comme « domicile politique » (dont un, Castinelli, semble davantage lié à Pise), contre vingt-trois à Pise, tandis qu’avec huit noms, Volterra est presque autant représentée que le chef-lieu de département. De plus, sur les vingt membres du conseil général, seuls sept sont livournais. Ces derniers sont aussi minoritaires, de peu il est vrai, dans le conseil d’arrondissement (cinq sur onze).
source : Publications de l’École française de Rome :https://www.bertrand-malvaux.fr/admin/1/Produits/48955/form/update?controllerName=Produits
Price :
700,00 €
| Destination | Envoi recommandé | Envoi Recommandé + Express |
|---|---|---|
| Shipping France | 9,00 € | 30,00 € |
| Shipping Europe | 17,00 € | 50,00 € |
| Shipping world | 30,00 € | 70,00 € |
Insurance (1%) :
7,00 €
Reference :
31661C
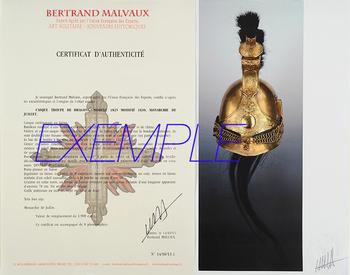
Next update Friday, February 13 at 13:30 PM
FOR ALL PURCHASES, PAYMENT IN MULTIPLE CHECKS POSSIBLE
bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63
SHIPPING COSTS
Shipping costs are calculated only once per order for one or more items, all shipments are sent via registered mail, as this is the only way to have proof of dispatch and receipt.
For parcels whose value cannot be insured by the Post, shipments are entrusted to DHL or Fedex with real value insured, the service is of high quality but the cost is higher.
RETURN POLICY
Items can be returned within 8 days of receipt. They must be returned by registered mail at the sender's expense, in their original packaging, and in their original condition.
AUTHENTICITY
The selection of items offered on this site allows me to guarantee the authenticity of each piece described here, all items offered are guaranteed to be period and authentic, unless otherwise noted or restricted in the description.
An authenticity certificate of the item including the description published on the site, the period, the sale price, accompanied by one or more color photographs is automatically provided for any item priced over 130 euros. Below this price, each certificate is charged 5 euros.
Only items sold by me are subject to an authenticity certificate, I do not provide any expert reports for items sold by third parties (colleagues or collectors).
FOR ALL PURCHASES, PAYMENT IN MULTIPLE CHECKS POSSIBLE
bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63
An authenticity certificate of the item including the description published on the site, the period, the sale price, accompanied by one or more color photographs is automatically provided for any item priced over 130 euros. Below this price, each certificate is charged 5 euros.
Only items sold by me are subject to an authenticity certificate, I do not provide any expert reports for items sold by third parties (colleagues or collectors).


